Procédure
- Chargement des images : lister les images disponible de M16 avec un rayon de recherche de 14' dans le serveur d'images Aladin en utilisant le menu : Fichier ⇒Charger une image astronomique⇒serveur d'images Aladin. Charger l'image dans le visible POSSI O-DSS2 750 avec un champ de vue de 13' X 13' et l'image dans l'infrarouge proche 2MASS K(IR K) 99052S_KI1320103 dont le champ de vue est 8.6' X 17.1'.
- Gestion du contraste des images : La dynamique des valeurs d'intensité des images astronomiques, c'est-à-dire leur contraste, est représentée dans le logiciel par le moyen d'une table de gris qui établit une correspondance entre l'intensité mesurée en chaque pixel de l'image et un niveau de gris. Aladin effectue un échantillonnage des pixels de l'image afin d'appliquer un seuillage : toutes les valeurs de pixels inférieures au seuil bas sont affichées en blanc, celles au-dessus du seuil haut en noir et les valeurs intermédiaires sont converties entre 0 et 255 linéairement (sur les matériels informatiques actuels le rendu visuel monochromatique est codé sur 1 octet) et affichées en niveaux de gris. L'utilisateur peut modifier le contraste des images en appuyant sur le bouton pixel accessible dans la barre d'outils à droite de l'image. Un exemple de la fenêtre qui s'affiche est montré sur la figure Fenêtre de contrôle de la dynamique des pixels. Il s'agit d'un histogramme de la répartition des pixels entre la plus petite et la plus grande valeur retenues par Aladin, qui peut être plus simplement interprété comme le nombre des pixels en fonction de l'intensité mesurée et donc émise par les objets (gaz, étoiles, poussières) contenus dans la région observée. Pour augmenter ou diminuer le contraste de l'image il suffit de modifier la fonction de transfert qui établit la correspondance entre les valeurs d'intensité des pixels et le tableau de gris. Le maximum du contraste est obtenu en activant la fonction Log dans la fenêtre de la dynamique des pixels. On peut également déplacer les curseurs en bas de l'histogramme pour modifier les seuils de l'image afin de rendre plus ou moins visible l'émission des différents objets ou zones de l'image.
- Extraction des contours : Aladin fournit un outil graphique permettant de générer des isophotes (courbe d'égale intensité lumineuse) d'une image. En appuyant sur le bouton cont de la barre des outils à droite de l'image on active une fenêtre (un exemple est montré sur la figure Fenêtre de contrôle des isophotes) qui permet d'ajuster le nombre de contours souhaités (à chaque contour est associé un curseur) ainsi que le niveau d'intensité correspondant. La fenêtre affiche en effet l'histogramme de la distribution des pixels présents dans l'image et les curseurs donnent les valeurs des pixels en correspondance avec les niveaux de gris. Leur déplacement se fait selon les même critères utilisés pour la gestion du contraste de l'image. L'extension des contours croît avec le nombre de pixels décomptés à la position du curseur qui correspond à une valeur d'intensité de pixel.

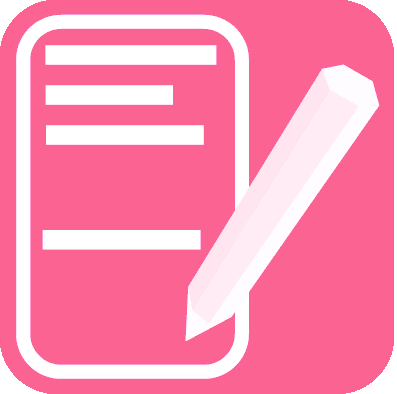 Génération et comparaison de contours dans l'infrarouge et le visible
Génération et comparaison de contours dans l'infrarouge et le visible
Ce TP consiste à appliquer les opérations décrites en détail dans la section précédente sur deux images de la nébuleuse de l'Aigle dans le visible (POSSI O-DSS2 750) et dans l'infrarouge proche (2MASS K(IR K) 99052S_KI1320103) et à analyser les informations complémentaires dérivant des observations dans ces deux bandes du spectre électromagnétique.
Question 1)
Modifier le contraste de l'image 2MASS K(IR K) 99052S_KI1320103 de façon à mieux visualiser les régions de l'image caractérisées par des valeurs d'intensité faibles par rapport aux étoiles brillantes qui dominent l'image d'archive. Utiliser à la fois la fonction de transfert et le déplacement des curseurs dans la fenêtre de la dynamique des pixels.
Solution
La première opération pour augmenter le contraste consiste à modifier le choix de la fonction de transfert qui est par défaut linéaire. En choisissant une échelle logarithmique on obtient une image très contrastée. Pour distinguer les régions de faible émission il faut modifier le seuillage et le tableau de gris de l'image en déplaçant les curseurs de seuil haut et intermédiaire à gauche de la fenêtre de contrôle. Résultats avant et après modification

Question 2)
Cocher l'icône correspondant à l'image contrastée dans l'infrarouge proche et tracer quatre isophotes représentatives des étoiles faibles dans le champ de vue. Puis sélectionner l'image dans le visible POSSI O-DSS2 750 (cliquer sur l'icône des contours de l'image dans l'infrarouge pour la désactiver) et générer les contours correspondant aux étoiles brillantes ainsi qu'à l'intense émission diffuse environnant les piliers, et à deux niveaux de l'émission du fond de l'image. Dans la représentation des intensités au moyen de la table de gris, ce fond plus clair correspond à l'absorption dans le visible due à la poussière. Noter que les échelles de gris pour les deux images sont différentes, le niveau de gris du fond de l'image dans le visible étant plus foncé que celui de l'image dans l'infrarouge.
Solution
Pour générer des contours correspondants à des faibles intensités sur l'image dans l'infrarouge il faut déplacer les curseurs à gauche vers les valeurs de pixel moins élevées. Sur l'image dans le visible le déplacement des deux curseurs bien à droite de l'histogramme de la distribution des pixels permettra d'associer des isophotes aux étoiles brillantes et à l'émission autour des piliers. Enfin, en positionnant deux curseurs environ au centre on rendra compte d'un premier niveau d'absorption correspondant au profil externe des piliers et un deuxième plus prononcé à leur intérieur. Résultats

Question 3)
Superposer les contours des deux images (en cliquant sur les deux icônes contours) et commenter les différences : 1) quelle émission est dévoilée par les contours de l'image dans l'infrarouge ? 2) et quelle émission est tracée par les isophotes de l'image dans le visible ?
AideSolution
Charger et superposer (en passant sur l'icône correspondante sans la cocher) l'image en vraies couleurs utilisée dans la première partie du TP ("Pillars of Creation in a Star-Forming Region" avec un champ de 2.6' X 2.5' , logHST) pour mieux comprendre les différentes contributions à l'émission dans le visible.
L'image dans l'infrarouge proche révèle la présence d'un grand nombre d'étoiles invisibles en optique. En particulier, les observations dans cette bande du spectre permettent de pénétrer plus en profondeur dans la poussière dense et de dévoiler des étoiles très jeunes à l'intérieur des piliers. Les deux premiers contours dans le visible correspondent aux piliers obscurcis de gaz sous forme moléculaire mêlés aux poussières, le troisième au flot de photo-évaporation (particulièrement visible aux sommets des piliers dans l'image HST) qui trace la matière photo-ionisée chaude s'échappant du nuage moléculaire vers la région HII ionisée. Cette photo-évaporation est induite par le rayonnement ultraviolet des étoiles brillantes, qui sont représentées par le quatrième contour. Résultats
